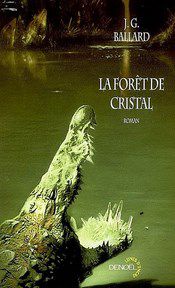J.G. BALLARD - La forêt de cristal
Le Tailleur de Glace
Auteur anglais, né en Asie en 1930, JG Ballard se consacre très tôt à la littérature de science-fiction en proposant ses nouvelles au magazine New Worlds dès 1950. Ses premiers romans s’ancrent dans le courant SF post-apocalyptique très en vogue dans l’Angleterre des années 60. La Forêt de Cristal (1966) appartient à ce qu’on pourrait appeler « le quatuor cataclysmique » de l’écrivain, qui intègre, en plus de ce roman suscité, Le Monde Englouti (1962), Le Vent de Nulle Part (1962), et Sécheresse (1965). Deux romans de Ballard seront portés à l’écran : le premier, Crash (1973) par David Cronenberg, et le second, l’Empire du Soleil (1985), roman mi-autobiographique que Steven Spielberg mettra en images avec une sensibilité tout à fait respectueuse de l’œuvre d’origine que le cinéphile, autant que le lecteur, se doivent de féliciter…
Synopsis de lumières
Appelé par deux collègues à se rendre à Mont-Royal, petite localité du Cameroun, en vu d’étudier un phénomène de nature inexpliquée, le docteur Sanders, arrivé à Port Mattare, se heurte à la langue de bois des populations locales et à l’intransigeance bornée des autorités. L’important contingent de l’armée déployé sur place pour maîtriser une situation entourée de mystère, ainsi que la profonde atmosphère de tension régnant sur le port - atmosphère renforcée par un paysage qui semble baigné dans un crépuscule permanent où chaque couleur s’érode au fil des jours qui passent – ne sont pas pour rassurer le nouveau venu. De rencontre en rencontre, et à force de persévérance, le professeur Sanders va pourtant finir par atteindre son but : la bourgade de Mont-Royal, sise au cœur de la forêt équatoriale. C’est là qu’il va mesurer toute l’ampleur du mal qui frappe la région : un virus inconnu, à la progression inexorable, qui s’attaque au paysage, qui avance, se répand sur toute chose, emprisonnant chaque parcelle de terrain, chaque bloc de construction, chaque pousse de végétation dans une gangue de glace imperméable, figeant le décor dans un inextricable réseau de piques et de ramures vitrifiées, érigeant des arches et des nefs de verre pour former une cathédrale taillée dans un marbre de lumière, allégorie démesurée de la beauté la plus pure, de l’entropie la plus folle. Une beauté qui fascine autant qu’elle fait tourner la raison : le mal attire ainsi les hommes dans son piège de cristal en leur promettant une douce immortalité au sein de sa prison où le temps, en suspend, devenu abstraction, n’a plus d’effet sur les corps immobiles.
Promesse de paradis ? Ou miroitement fallacieux de l’enfer ?
Le professeur Sanders y succombera-t-il ?
Une apocalypse figée
Nouveau visage de l’apocalypse que nous dévoile ici Ballard. Certainement la vision la plus poétique et la plus sensible que l’on puisse trouver sur ce thème dans la littérature.
« Vision ». Oui. C’est le terme approprié.
A l’immoralité sans vergogne d’un Terre Brûlée, à la violence décomplexée d’un Jour des Fous, l’auteur oppose une vision emprunte de poésie, pleine d’une luminosité miroitante, pleine d’une beauté secrète ; une vision où tout est figé dans une sorte de gangue intemporelle, et où le décor, immobile sous les éclats de milles scintillements, enferme les existences comme la main d’un Dieu las.
Caractéristique essentielle du roman : ce décor - que met en place Ballard et qu’il dépeint d’une plume « illuminée » - est un acteur à part entière, un personnage autonome ayant autant d’importance que les protagonistes qu’il abrite en son sein gelé.
Nouveau visage de l’apocalypse, donc. Le rythme de cette Forêt de Cristal n’est en rien précipité. Tout n’est que lenteur. Une lenteur contemplative. Fixité des éléments pétris dans un moule de beauté absolue qui entraîne, autant chez le lecteur que chez les différents personnages mis en scène, une sorte d’érosion des pensées… Le temps lui-même est décousu, il se déroule au ralenti, vers un avenir flou. Les héros ne courent vers aucun but. Ils semblent « tourner en rond ». Quelques phases d’action surnagent dans cet océan de placidité, mais elles apparaissent au lecteur comme superficielles, voir décousues. De l’émail sur le miroir. Car en réalité, les personnages sont prisonniers du labyrinthe de cristal. Ils sont perdus dans les méandres tortueux de leur propres désirs inavoués autant que dans l’enchevêtrement des sentiers vitrifiés qui dirigent leur déambulations vaines. Ils errent, à la recherche d’un idéal qui ne peut trouver sa consécration que dans leur abandon total au mal qui les cerne. Le héros lui-même, le Docteur Sanders, ne sait pas ce qu’il désire réellement. Retrouver Suzanne Clair, son amante ? Est-ce vraiment sa motivation ? Non. Il y a avant tout cette forêt de cristal. Ce mal venu du ciel, qui attire autant qu’il fascine : fascine par sa beauté divine qui sublime toute chose ; attire par les promesses d’immortalité qu’il offre aux êtres qu’il emprisonne.
Ici, tout n’est que beauté. Tout n’est que lenteur. Tout n’est que pureté. Les heures s’égrènent au ralenti pour présenter au lecteur une forme nouvelle de fin du monde : une agonie par « l’immobilisme ». Une apocalypse « passive », « figée ».
Ce rythme tout à fait particulier, et tout à fait novateur, que cultive Ballard – et que l’on retrouvera, comme une forte continuité, dans les trois autres éléments de son « quatuor cataclysmique » – peut rebuter le lecteur en mal d’action. Dans La Forêt de Cristal, la vision générale de l’écrivain, véritable illumination poétique, l’emporte sur l’évolution (secondaire) des personnage et de l’intrigue. La contemplation prévaut sur l’action. Par son décor féerique et ses allusions multiples aux contes de fée (La Belle aux Bois Dormants, La Bêle et la Bête, Le Bossu de Notre Dame…), le roman nous absorbe dans une dimension merveilleuse, miraculeuse, pleine d’illusions, où les arbres sont des géants de glace foulant un parterre rayé de mille feux, où les maisons pétrifiées sont semblables à d’immenses châteaux d’argent au sein desquels les héros (é)perdus viennent provisoirement trouver refuge en attente de leur purification ; une dimension où, finalement, avec une extase sucrée, le lecteur s’abandonne, se perd volontairement lui-même. Dès lors, la fin du monde que nous décline Ballard se présente moins comme une justification de la fin de l’Humanité que comme un retour au sens étymologique du mot « apocalypse » : à savoir, une « révélation »…
Conclusion ?
Il faut se plonger tout entier dans ce roman et vibrer en imagination au diapason de la vision dépeinte par l’auteur pour appréhender à sa juste valeur cette Forêt de Cristal. Alors seulement, La Forêt de Cristal peut s’imposer à nous pour ce qu’elle est : une œuvre majeure. Un tableau peint en mots dans lequel s’entrelacent beauté et poésie, où l’homme, le végétal, et le minéral fusionnent, matières intriquées comme autant de ramures cristallisées, où la lenteur précipite l’inéluctabilité de la fin… Ainsi, La Forêt de Cristal dépasse-t-elle le cadre stricte de la science-fiction pour atteindre à un univers du merveilleux qu’il est difficile de définir, mais qu’il est plus aisé de lire… Parce que le roman possède un rythme particulier, les plus pressés des lecteurs l’abandonneront certainement en route. Et on ne peut leur en vouloir. Mais pour ceux sensibles à la poésie, à la vision prégnante d’un écrivain, pour ceux qui aiment prendre le temps de la contemplation, La Forêt de Cristal sera un voyage qu’ils ne seront pas près d’oublier.
Extraits
« Elle attendit près du lit tandis qu’il marchait sur le tapis fané, ouvrait les panneaux grillagés. Il leva les yeux vers un ciel plein d’étoiles, vit les constellations d’Orion et du Taureau. Une immense étoile passait devant elles, émettant une énorme couronne de lumière qui éclipsait sur son passage les étoiles de moindre grandeur. Tout d’abord, Sanders ne reconnut pas en elle le satellite Echo. Sa luminosité était dix fois plus forte qu’auparavant, transformant le petit point de lumière qui avait sillonné le ciel nocturne si fidèlement pendant tant d’années en un astre brillant dont l’éclat ne le cédait qu’à celui de la lune. Il devait être visible dans toute l’Afrique, de la côte libérienne aux rives de la mer Rouge, vaste lanterne aérienne embrasée de la même lumière qu’il avait vue dans les fleurs de pierre précieuse cet après-midi.
Il se dit sans y croire que le ballon éclatait peut-être, se désintégrait, formait un nuage d’aluminium, gigantesque miroir. Il observa le satellite jusqu’au moment où il s’enfonça au sud-est. Quand il disparut, la sombre voûte de la jungle scintilla de milliers de points de lumière. A côté du Dr Sanders, le corps blanc de Louise étincelait dans une gaine de diamants et la sombre surface du fleuve au-dessous d’eux luisait, pailletée comme le dos d’un serpent endormi. » (P47).
« Ils se penchèrent tous en avant, stupéfaits, retenant leur souffle, les yeux écarquillés devant la longue ligne de jungle en face des bâtiments de bois blanchi de la ville. Le Grand arc d’arbres surplombant l’eau paraissait ruisseler, étinceler de myriades de prismes ; leurs troncs et leurs branches gainés de bandes de lumière jaune et carmin teintaient de sang la surface du fleuve comme si toute la scène eût été reproduite en un technicolor trop vif. Sur toute sa longueur, le rivage en face d’eux étincelait comme vu à travers un kaléidoscope brouillé, les bandes de couleur empiétant l’une sur l’autre accroissaient la densité de la végétation si bien qu’il était impossible de voir plus de quelques pieds entre les troncs de la première rangée.
Le ciel était clair, immobile, le soleil brillait sans arrêt sur ce rivage magnétique, mais de temps à autre un souffle de vent ridait le fleuve et la scène éclatait en cascades de couleurs qui partaient en ondes dans l’air autour d’eux. Puis cette coruscation s’atténuait et les images des arbres réapparaissaient, chacun gainé de son armure de lumière avec un feuillage luisant comme s’il eût été chargé de joyaux déliquescents. » (P83)
« Et je suis convaincu, Paul, que le soleil lui-même est efflorescent. Au crépuscule, quand son disque est voilé par la poussière pourpre, il semble que s’entrecroise à sa surface un treillis bien particulier, une vaste herse qui s’étendra un jour jusqu’aux planètes et aux étoiles, les arrêtant dans leur course… ».
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres