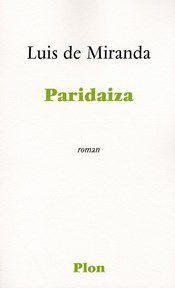Luis DE MIRANDA - Paridaiza
Jeune auteur francophone papa d’une petite dizaine d’essais et de romans, Luis DE MIRANDA, au travers de ses différents écrits, poursuit son illustration de la notion philosophique de « créalisme » dont il est le géniteur.
Paridaiza s’inscrit dans cette veine.
Nous sommes en 2012. A Paris.
Dans un monde rongé par le sentiment de solitude et d’anonymat qui isole les foules, Paridaiza, univers informatiquement simulé, est le refuge des âmes en peine. Dernier cri de la réalité virtuel, il propose à ceux qui s’y connectent d’y vivre une existence parallèle à leur réalité, et au sein de laquelle les plaisirs peuvent se voir démultipliés grâce au « Sensorium ». Très prisée, et devenue une véritable drogue pour ses adeptes, la fonction du « Plaisirium » apporte à ses bénéficiaires une extension jouissive des sensations corporelles lors des rapports sexuels. Seule la frange des « collectifs », dévoués au bon fonctionnement de cette société artificielle, peut prétendre y avoir accès. Au sommet de sa tour Absolux sise au cœur du « Vivarum », le jeune Angelot Malaner, double numérique du principal créateur de Paridaiza, domine son œuvre et dirige la masse des avatars en mal de sensations fortes, épaulé dans le quotidien de sa tâche par un parlement qui occupe de plus en plus de place au sein de la pseudo vie politique de la Cité.
Dans le Paris bien réel cette fois-ci, Nuno, la vingtaine, bibliothécaire, et Clara, le double de son âge, pianiste concertiste, vivent une relation tumultueuse qui a le plus grand mal à suivre une trajectoire sereine. Clara désire un enfant. Nuno, trop jeune, trop volage, redoute d’assumer une responsabilité qui le fasse s’engager à vie... Au terme d’une énième séparation, et pour noyer son chagrin, Nuno décide de faire l’expérience du Paridaiza en s’y connectant, poussé secrètement par le désir de rencontrer de nouveau Angelot Malaner, grand créateur de cette œuvre, et ancien ami d’enfance. Poussé aussi par le besoin d’oublier son mal-être dans les promesses effervescentes qu’ouvrent à l’imagination les plaisirs décuplés du « Plaisirium » dans lesquels certains se noient sans jamais pouvoir en revenir…
Séparés dans la vie réelle, les deux êtres qui nourrissent cependant l’un envers l’autre un amour sincère, profond, inaltérable, vont se (re)trouver, par le biais de cette réalité virtuelle, et, pour le meilleur comme pour le pire, être les acteurs d’un bouleversement sans précédent dans l’histoire de Paridaiza.
Paridaiza se veut donc l’illustration de la thèse « créalisme » chère à l’auteur, développée au cours de ses travaux universitaires et mise en forme à la faveur de ses expériences menées sous « Arsenal Midi ». Si le postulat du « créel » peut exciter la curiosité, le lecteur lambda abordant le roman n’est pas censé en connaître les subtilités. Et d’un point de vue strictement littéraire, force est de constater que Paridaiza se révèle vite limité. Les protagonistes, principaux comme secondaires, nous apparaissent en effet fades, sans épaisseur, plus proches a vrai dire de la consistance ectoplasmique des fantômes numériques qu’ils incarnent la majorité du temps dans leur bulle de savon monochrome que des êtres bien en chair et en os, pétris d’humanité et de tourments, que l’on rencontre au détour du réel concret, dur, saignant… Conséquence immédiate de cette superficialité : impossible de s’attacher aux personnages dont on suit les pérégrinations. Impossible de rentrer dans leur jeu. D’appréhender leurs enjeux. Toute identification est forcée. Comme si un écran s’érigeait entre les acteurs de ce « jeu » et l’imaginaire du lecteur, freinant l’immersion de ce dernier dans l’univers de ces premiers. On lit, mais sans y croire un seul instant… Par corollaire, le sujet du roman, au même titre que l’intrigue, en devient rapidement d’un manque d’intérêt confondant, qui nous fait lentement mais sûrement glisser sur la dangereuse pente de l’ennui. Ce cruel manque de dynamique, de perspective généralisée, est peut-être du à l’hésitation éditoriale dont pâti Paridaiza. Le roman évolue en effet à la lisière des genres : il ne se raccroche pas vraiment à la SF, ne faisant qu’en effleurer la surface… Il refuse tout autant de s’ancrer, par la nature de son sujet, dans une littérature plus « générale ». Et le lecteur se retrouve de ce fait à cheval entre deux sphères, incertain, boitillant, cherchant des marques de repères, des balises, là où son imaginaire ne fait que glisser sur des reflets mimétiques imprécis et superficiels. Tout le roman souffre de cette scoliose générique. La prose en elle-même semble véhiculer et entretenir le ronron monotone de disque dur soufflé par cette ambiguïté : bien que travaillée, et non dénuée d’une indiscutable fibre poétique, elle finit par lasser et endormir le lecteur par son côté trop sage, trop propre, trop lisse, trop…convenu. La fin du roman en elle-même n’apporte pas la chute salvatrice tant attendue. Et le livre refermé, ne reste en mémoire – et pour tout souvenir de lecture – qu’un cuisant sentiment de fadeur doublé d’une désagréable impression de superficialité, voire d’inachevé.
On nous promettait une « anticipation poétique », un texte « onirique et singulier ». Mais la sauce ne prend pas. Si Luis DE MIRANDA trouvera peut-être un écho enthousiasme auprès d’un lectorat populaire plus enclin à l’indulgence, ou auprès d’un noyau d’aficionados respectueux de ses théories philosophiques, il ne comblera définitivement pas l’attente des lecteurs de SF convertis, exigeants de nature, qui préfèreront se tourner vers des œuvres résolument moins hésitantes et autrement plus ambitieuses et abouties.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres