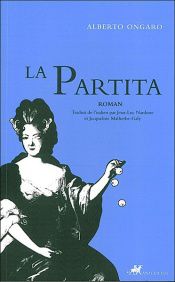Alberto ONGARO - La partita
Il y avait eu ce miraculeux voyage, que les éditions ANACHARSIS nous avaient offert en traduisant l’année dernière Le Secret de Caspar Jacobi, initiative qui avait permis au lectorat francophone d’entrer en contact avec l’œuvre d’un auteur italien mésestimé sur notre territoire : Alberto ONGARO. Seconde tentative de cet audacieux éditeur indépendant avec la publication et la traduction cette année de La Partita, roman originalement paru en 1980 en Italie, et qui a valu à son auteur le prix Campiello en 1986.
Le roman s’ouvre sur les flots : une galéasse, voguant en direction de Venise, ramène le jeune Fedrigo Sacredo, condamné à l’exil une année durant pour avoir fait tâter de son épée à un jeune prétentieux, dans sa ville natale où l’attendent le confort, le luxe et l’oisiveté qui sied à la fortune familiale. Ce qu’il ne peut savoir, c’est que cette fortune colossale, son diable de père l’a presque intégralement perdu au jeu contre une adversaire des plus pernicieuses : la Comtesse Mathilde Von Wallenstein. Saisi d’une frénésie indicible, rien ne semble pourvoir raisonner l’unique dépositaire de la fortune Sacredo. Alors, le jeune fils accourt pour tenter de mettre fin à cette partie qui saigne son héritage et signe sa ruine. En vain. La comtesse, jamais rassasiée, toujours plus carnassière, démon borgne aux canines immaculées, va même plus loin dans son entreprise de dilapidation en proposant au fils une offre diabolique : une ultime partie. Les dès eux seuls décideront. Si le hasard désigne Fedrigo Sacredo comme vainqueur, l’intégralité de la fortune patriarcale jusqu’alors misée et perdue lui reviendra de droit. Si le hasard le condamne, il fera de sa personne une possession dont la comtesse disposera à sa guise. Par excès de confiance en soi, par témérité autant que par vanité, le fils acculé décide de relever le défi et, devant une assistance silencieuse et masquée, signe un accord officiel qui scelle son destin. Le malheureux ne sait pas qu’il affronte un adversaire dont le hasard semble la moitié… L’issu de leur duel ne peut que lui être fatale… Et placé en face d’un avenir qu’il sait désormais conjugué selon le bon vouloir d’une femme abhorrée, Fedrigo Sacredo, déchu, n’a pas d’autre choix que de fuir… C’est le début, pour notre héros, d’une interminable fuite pour échapper à ses poursuivant acharnés : les frères jumeaux Podestas, redoutables sicaires ayant commis les pires sévices, et dorénavant au service de la comtesse. La menace avait été clairement énoncée, sur le ton glacial de la prémonition : « Je ne crois pas que vous parviendrez désormais à dormir tranquille la nuit. ». Et la chose, aux yeux du fugitif, se révèle au fil de sa course, des villes qu’il traverse, des auberges qu’il occupe ponctuellement, dans toute sa réalité : car il ne se passe pas un instant sans que Fedrigo Sacredo ne soit tiraillé par la présence pourtant lointaine de cet être machiavélique. Et dans chaque recoin où dansent les ombres, ce sont les silhouettes embusquées des frères Podesta, armés de leurs lames tranchantes, qu’il croit apercevoir.
Jusqu’où le mènera sa fuite ?
Trouvera-t-elle au moins une fin ?
C’est donc à un roman dans la plus pure tradition du roman picaresque du XIXè siècle que nous convie l’auteur italien avec La Partita. Ses lecteurs francophones avaient déjà pu goûter son amour du genre au travers de ses deux romans déjà traduits en France : Le Secret de Caspar Jacobi, et La Taverne du Doge Loredan récemment sorti en poche. Si ces deux romans développaient un jeu tout à fait jubilatoire sur les constructions narratives en jouant à part égale avec le narrateur, l’auteur, les personnages mis en scène, mais aussi le lecteur lui-même pris au piège de l’intelligence émoustillante de l’écrivain, La Partita, publiée en 1980, se veut moins intellectuellement stimulante, dirons-nous, plus formelle, plus conventionnelle. Le roman ne se double en effet d’aucune sensation de vertige ou de désorientation au contact de quelques malicieux méandres de l’esprit de l’écrivain. La langue est cependant toujours aussi délectable, le style toujours aussi soutenu, le rythme toujours aussi enlevé, et la traduction (signée Jean-Luc Nardone et Jacqueline Malherbe-Galy), pareillement réussie.
La grande originalité de La Partita tient au fait que l’action de l’aventure, l’intrigue qui met en opposition deux adversaires dans une partie à distance, ne nous est rapportée que de l’unique point de vue de Fedrigo Sacredo, le narrateur. Comment dès lors connaître les initiatives et déplacements de ses poursuivants ? En se fiant à son imagination. En écoutant son intuition. En anticipant. C’est ainsi que la fuite frénétique de notre héros ne se voit presque jamais étayée par des évènements concrets : c’est son imagination seule qui tisse la mosaïque, brode la trame formant l’intrigue du récit ; c’est sa volonté seule, aiguillonnée par la crainte d’être rattrapé par les assassins lancés à ses trousses et par la perspective d’être assujetti à la comtesse, qui impose à son imaginaire des ennemis immatériels, invisibles.
Invisibles donc surnaturels ?
Le lecteur serait tenté de le dire. Et il est certain que l’écrivain se plaît à jouer avec les codes du genre, à en étirer / triturer les frontières, à cultiver une ambiguïté trompeuse qui confère une certaine épaisseur à son roman. L’aspect animal et cruel de la comtesse, autant que son don au jeu et sa capacité à faire sentir constamment sa présence maléfique par-dessus les épaules du narrateur, épiant ses faits et gestes à des lieux de distance, lui donne une aura inhumaine. Il en va de même pour les deux sicaires qui, à eux seuls, déciment des armés, abattent le moindre obstacle faisant barrage à l’exécution de leur mission. A plusieurs reprises, ils sont associés à des « démons », à des « Demi-dieux ». Ils incarnent incontestablement la poigne du destin qui, impavide, inévitable, frappe, s’exécute contre toute volonté. Une filiation intéressante pourrait être établie entre ces deux personnages et le personnage de Cigur, tueur implacable de No Country For The Old Man de Cormak MCCARTHY. Ou, peut-être plus à propos, avec celle du Commandeur d’un Don Giovanni, incarnation de l’inéluctable fatalité…
Surnaturelle, La Partita ?
Le terme est évidemment trop fort. L’adjectif adéquat, ou se rapprochant, par certains endroits, de l’étrange atmosphère du roman, serait peut-être « merveilleux ». Merveilleux comme cette Venise intégralement prise sous la glace en début de roman, comme sa lagune devenu un miroir aux étoiles, Venise immaculée et figée dans le temps qui offre au narrateur et au lecteur une vision de Conte de fées. Merveilleux comme ces personnages emblématiques, hauts en couleurs, que rencontre l’infortuné Fedrigo Sacredo aux détours de ses incessantes pérégrinations : Olivia, jeune femme ouverte au péché charnelle souffrant d’un égocentrisme maladif ; l’abbé loquace confectionneur de dentiers ; le prince octogénaire édenté au physique herculéen, maître de mille chiens, marié à une épouse de…76 ans sa cadette ; ou encore ces trois êtres étranges à l’apparence rebutante de gnomes profitant d’une chance insolente… Oui. Le merveilleux tapisse le territoire de La Partita, mais c’est surtout et avant tout du côté du théâtre qu’il faut aller chercher les inspirations et références de l’écrivain, comme nous le pointe si justement le narrateur :
« Nombre de péripéties doivent encore être racontées, trop de personnages attendent encore dans les coulisses. » (P56)
« J’avais aussi l’impression bizarre de jouer un rôle dans une comédie à la mode où s’entrelaceraient les thèmes de mon siècle et ceux des siècles passés, de participer à une représentation théâtrale dans laquelle frivolité, déchéance, libertinage et tragédie coexistaient. » (P121)
« Il semblait que le théâtre de marionnettes où j’avais l’impression de me déplacer disposât d’un espace beaucoup plus ample et profond que ne le donnait à penser sa structure minuscule. […] Du milieu de la scène, je regardais vers les spectateurs… ». (P155)
« …Si bien qu’il me parut que je ne racontais pas une histoire vraie, mais une tragi-comédie, une sombre farce et que j’étais soudainement devenu un héros mal ficelé et discutable du théâtre populaire. » (P274).
Notre héros fugitif qui s’enfonce un peu plus à mesure de son avancée dans une paranoïa sans rémission pourrait voir son acuité vis-à-vis de sa condition de personnage dramaturgique dictée par la plume d’un Luigi PIRANDELLO. Ses tendances libertines évoquent clairement un Casanova. Quant à son imagination débridée qui referme progressivement son piège sur son devenir, elle pourrait très bien emprunter à un personnage sorti d’un Conte de BORGES qui tenterait de réécrire l’histoire de Don Quichotte…
Merveilleuse et oppressante illustration d’une traque éternelle, roman aussi sournois qu’intelligent, La Partita ne possède peut-être pas la dimension interrogative et la désopilante profondeur de ses aînés que sont Le Secret de Caspar Jacobi ou bien La Taverne du Doge Loredan. Mais elle n’en constitue pas mois un excellent moment de lecture pour les amoureux de la belle langue et de la littérature d’aventure héritée du XIXè siècle.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres