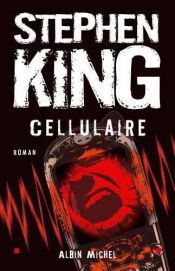Stephen KING - Cellulaire
Pour les fanatiques de l’écrivain américain dont je me revendique volontiers, ouvrir l’un des romans du maître ça se fait non sans un certain sens du religieux. Ça tient un peu du rituel à vrai dire. Parce que voyez-vous, nous, humbles lecteurs marqués au fer rouge d’un Fléau ou d’un Carrie ou d’un Part des ténèbres et j’en passe, on est quasi sûr qu’enfermé dans cette petite centaines de pages qu’on tient entre nos mains, il y a un voyage en gestation, qui nous attend bien sagement, et qui risque encore, peut-être pas d’ébranler nos convictions religieuses ou nos considérations philosophico-théologiques, mais au moins de nous ouvrir quelques nouveaux champs inexplorés de l’imaginaire, du fantastique ou de l’horreur ; d’actionner les leviers secrets qui soulèveront en nous fascination, dégoût, surprise, émerveillement ; de toucher ces « points de pressions phobiques » – si chers à l’écrivain – pour faire hurler mémé dans son fauteuil à bascule jusqu’à la renverse, les quatre fers en l’air, et tout et tout. Faire couler la sueur. Rouler le frisson. Dresser les poils (décidément). Rendre les mains moites. Un goût de zinc dans la gueule. Le palpitant qui pompe à mort. Vous connaissez la musique… C’est celle qu’épluche avec tant de talent monsieur King depuis bon nombre de romans et avec un savoir-faire égal qui n’appartient qu’à lui. Et que beaucoup lui envie. Moi le premier. Ce n’est peut-être donc pas – soyons raisonnable – en dévot fanatique et absolu que j’ai entamé ce Cellulaire. Mais, soyons honnête, avec une once certaine d’impatience et de fébrilité.
La question est : Le feu en valait-il la chandelle ? Ou, plus juste à propos : L’appel justifiait-il son tarif ?
Réponse in texto.
Allo la Terre ?
Ça démarre sur les chapeaux de roue. Tout de suite. Vlan. Pas le temps de respirer que déjà, le lecteur s’en prend plein la tronche. Il est tout décoiffé, même. Façon punk. Là où le maître nous avait habitué à prendre son temps pour camper un décor, déployer des situations, fouiller des personnages, nous ramener finalement dans un territoire familier en nous laissant tout le délicieux loisir de reprendre nos marques, ici, King nous coupe l’herbe sous les pieds. Il nous prend au dépourvu. Le chaos se déchaîne dès les premières pages. L’orgasme est rapide. Aussi brutal que spontané. Et à regret. Mais posons d’abord le tableau.
Clay, la trentaine, jeune auteur de BD, divorcé, père de Johnny, un petit garçon de douze ans, vient tout juste de concrétiser son rêve : signer un contrat juteux avec une maison d’édition qui est sur le point de publier, dans les semaines à venir, sa toute première BD… Plus de soucis d’argent à se faire ; terminées les récriminations de Sharon. L’avenir de Clay est assuré, et il se décline sous le soleil radieux des dollars.
On retrouve un peu cette même figure de « l’artiste aux portes de la gloire » dans Le Fléau, au travers du personnage tout à fait mythique de Larry Underwood, souvenez-vous, le rockeur ayant pondu un titre devenu un véritable tube : « Baby tu peux l’aimer ton mec ? ». Les deux personnages ont en commun d’être victimes d’une situation terriblement absurde, et non dénuée d’une certaine ironie : ils se trouvent au seuil de la gloire au moment précis où l’humanité bascule, où tout fout le camp, reléguant tout concept de « gloire » et autres « réussites sociales » à un signifiant désormais entièrement obsolète puisque la notion de « société » dans lequel il opérait vient purement et simplement d’être balayé par un facteur extérieur… Ah ah ah. Critique de la société de consommation déjà latente dans ce Fléau, donc, puisque, face à cette belle ironie (quel intérêt d’être l’auteur d’un tube écoulé à plusieurs millions d’exemplaires si il n’y a plus personne pour l’écouter ?) se pose la question plus profonde des valeurs humaines, de leur nature authentique...
Mais revenons à nos moutons électriques.
Clay donc, la planche de son « Vagabond des ténèbres » sous le bras, au sortir de sa première réunion avec son nouvel éditeur, décide de faire une petite halte chez un vendeur de glaces ambulant avant de reprendre la route pour Kent Pond où il est pressé de retrouver son ex Sharon pour lui annoncer, victorieux, la bonne nouvelle. Sa boule de glace, Clay ne la consommera jamais. Pour une raison assez valable au demeurant : d’un seul coup d’un seul, le monde entier qui l’entoure pète une durite. Et pas une petite… Les gens dans la rue se sautent à la gorge, se mordent, se bouffent, se déchirent, s’étranglent, s’étripent, s’entretuent en brayant des borborygmes qui n’ont plus rien d’humain. Un promeneur attaque son propre clébard en lui déchiquetant l’oreille à pleines dents – vous reprendrez bien un peu de sang ? Sauce Kanigou… –, un bus roulant à tombeau ouvert va s’encastrer dans un immeuble, des explosions barytonnent tout azimuts. Bienvenu en enfer. Et Clay, au milieu de ce chaos, happé par le magma de cette irruption meurtrière de folie et violence, bat des bras, tentant de comprendre ; mais par-dessus tout et avant tout, de survivre.
Voilà. On vient d’entamer le chapitre deux. Et ça démarre donc plutôt fort… On a le droit aux descriptions en vigueur de scènes épouvantables, de tueries plurilatérales, dans lesquelles les humains – relégués à de vulgaires corps sans âme, des espèces de coquilles vides, des pantins uniquement habités par le besoin de meurtre – s’attaquent à tout ce qui bouge. Jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il ne faut pas bien longtemps à Clay, notre héros – faisant preuve d’une perspicacité particulièrement aiguisée – pour établir une relation entre les téléphones portables et ce que les survivants de ce vaste merdier ne vont pas tarder à appeler « l’Impulsion » : les premiers se révélant les vecteurs, les relais diaboliques de la seconde…
Un coup de fil, et bonjour les barjos.
Ne le cachons pas, cette idée centrale sur laquelle repose le roman est bonne… Même si critiquable sur le plan de la vraisemblance. Et même si elle ne résulte en réalité que d’un procédé éculé, mainte fois exploité par l’écrivain au travers de ses œuvres antérieures ainsi que par bon nombre d’auteurs de fantastique ou d’horreur : à savoir cette habile manœuvre qui consiste, en partant d’un élément usuel tiré du réel, à distordre la fonction de l’élément en question pour le dénaturer, le destituer, et le muter en instrument de la monstruosité. Que l’élément soit un « cimetière », un « miroir », ou quoi que ce soit d’autre, il devient un intermédiaire par lequel la mort, la folie, et finalement le fantastique ou l’horreur, s’immiscent à grands fracas dans la réalité… Dans Cellulaire, le choix de l’objet n’est évidemment pas anodin. Mais j’y reviendrai.
C’est donc dans un environnement immédiatement apocalyptique que le lecteur met les pieds et que nos héros vont devoir patauger allègrement. Et survivre. Clay, lieder du petit groupe de « normaux » qui se forme, et une fois le contrecoup de ce bouleversement de grande envergure passé, ne va plus souffrir que d’une obsession : retrouver son fils, Johnny. Son ex, Sharon, il s’en fout un peu. De toute façon elle était chiante. Mais son fils… Non. C’est son véritable amour. C’est le seul truc qui le pousse encore à se battre. A avancer. C’est donc sur la route que la majorité du roman va se déployer. Réminiscence assumée du Fléau : des héros perdus, errant dans un monde dévasté, en proie à leurs préoccupations intérieures, combattant leurs vieux démons ainsi que les cruels souvenirs d’une existence passée à jamais révolue, se battant pour la vie… Finalement, la destination compte moins que le voyage (initiatique) qui y conduit…
Les références
Le bouquin est dédié par le maître à deux figures emblématiques du fantastique et de l’horreur :
« A Richard Matheson et George Romero »
Deux univers différents.
Le premier celui des mots ; littéraire.
Le second, celui des images ; cinématographique.
Le point de jonction de ces deux univers se trouve habillement amené par King au sein même du roman. Ce point de jonction est incarné par le personnage de Clay, héros principal, puisque ce dernier a pour profession d’être dessinateur de BD. Et quelle autre forme d’art mieux que la BD peut prétendre se trouver à la croisée du monde des mots et de celui des images ?… Au-delà de ce petit clin d’œil, la référence à l’œuvre de Matheson (Je suis une légende) et à celle de Romero (Zombie) trouve son écho dans Cellulaire au travers des personnages décérébrés et lobotomisés qui forment les restes de l’humanité et qui ont en effet toute l’apparence de ces Zombies mis en scènes dans les œuvres précitées… L’analogie touche cependant d’avantage la forme que le fond… Quoique… Tout comme dans Zombie, la dénonciation de la société de consommation fait parti d’un des thèmes adjacents du roman.
Armé de mon maigre bagage culturel et cinématographique, je trouve une autre référence à Cellulaire. Celle d’un film japonais : Tetsuo. Un film à voir, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Le film, qu’on pourrait qualifier de « choc cinématographique » sans qu’il n’y ait un mot de trop, narre la transformation d’un homme victime d’un accident de la route en monstre de fer et d’acier… Dit comme ça, pas très parlant. Mais à voir en noir et blanc, et avec des morceaux de ferrailles jaillissant des tripes et des plaies ouvertes du corps du malheureux, croyez-moi, c’est autrement traumatisant… C’est un peu ce qui arrive, au final, à l’humanité frappée par cette « Impulsion » : l’humanité se « machinise », « s’objétise ». Au sens primal du terme. Les hommes, dépossédés de leur mémoire et de leurs pensées, ne sont plus que des coquilles de chair vides tout juste bonnes à retransmettre le « signal du groupe » qui alimente, en réalité, une forme de pensée collective et télépathique. Des sortes de grotesque téléphones portables, faits d’os, de chair et de sang, à taille humaine. Voilà ce qu’ils sont devenus. Des hommes-objets désindividualisés. Cette vision, aussi grotesque qu’effrayante quand on la considère avec un peu de recul, fait assurément mouche, et cette déshumanisation de la race au profit d’une « machinisation » de l’espèce est sans le moindre doute l’un des points percutants du roman… A celui-ci, et l’alimentant comme un solide courant souterrain, j’ajouterais la longue métaphore filée présente tout au long du roman et qui entretient cette analogie mis en exergue en tissant un lien entre l’homme et la machine : le cerveau humain perçu comme le disque dur d’un ordinateur qu’on formate ; les pensées humaines comme des impulsions électriques parcourant un circuit…etc... King, en grand agitateur d’imaginaire qu’il est, tient son idée et l’amène jusqu’à son terme… La poussant dans ses plus effroyables retranchements, la pressant comme un juteux citron de sang. Au plus grand plaisir du lecteur avide, évidemment.
Plus de réseau
Attaquons les points critiquables. Car il y en a…
Tout d’abord, King, à bien y réfléchir, dans ce présent Cellulaire, ne produit rien de réellement neuf. Recyclant des ingrédients déjà exploités dans ses précédentes recettes littéraires (la télépathie, la télékinésie – Charlie, Carrie – la pensée collective, l’Apocalypse – Le Fléau –) il les rassemble ici pour nous concocter un bon gros gâteau enrobé d’une crème résolument « moderne ». Une crème moderne à la saveur un peu trop prononcée à mon goût…
Second point qui me dérange… On a un peu l’impression, à la lecture de Cellulaire, que l’une des principales préoccupations de King, à travers ce roman, est d’étoffer son panel de lecteurs, de l’élargir en tapant dans une nouvelle génération… Cela ne serait pas un point critiquable en soit si cette volonté n’était pas perceptible à la lecture. Ce qui est malheureusement le cas. En guise d’exemple : le personnage principal de Clay. King a ici mis de côté le rôle de l’écrivain « mature », « adulte » mis en scène dans La Part des Ténèbres, Shinning, ou Les Régulateurs, au profit d’un Clay plus jeune, rayonnant de sa petite trentaine d’années. De même, l’art au travers duquel Clay s’exprime est bien éloigné de l’aspect poussiéreux, ancestral de la littérature que pratiquaient ses illustres prédécesseurs puisqu’il s’agit de celui – plus « accessible » dirons-nous, ou en tout cas, plus « jeuns », sans à priori – de la BD… Cette volonté de se « mettre au goût du jour » est aussi décelable dans les nombreuses citations techniques et technologiques dont King ne manque pas d’agrémenter son roman, nous servant sur un plateau giratoire, et au travers du jeune personnage de Jordan, un bon paquet de vocable informatique que l’on sent néanmoins pas toujours maîtrisé…
Toujours sur le plan des critiques, la focalisation de la narration : restreinte uniquement à quelques personnages, elle ne nous permet pas de profiter d’une vision global du chaos qui secoue le monde. Le champ de perception, réduit au maigre spectre de quelques individus, fait perdre à la catastrophe son ampleur, sa portée, et donc, amenuise son impact… L’« Impulsion » a-t-elle été un phénomène à la portée mondiale ? Le lecteur n’en a pas vraiment l’impression. A la liste des questions posées auxquelles l’écrivain ne répond pas, il faut ajouter celles concernant l’origine même de cette « Impulsion » ; de son but. « Qui en est l’instigateur ? Pourquoi ? ». Autant d’énigmes qui resteront à jamais irrésolues. Dans la continuité de cette amère sensation d’inachevé, la fin du roman, la chute, que je tairai ici, mais qui nous laisse un peu beaucoup sur notre faim, quand même…
Ce coup de lifting général, enfoncé à coups de maillet dans les mirettes du lecteur, ajouté à un manque patent de renouvellement des thématiques, et à quelques maladresses de la narration, pèse sur la globalité de Cellulaire… Et si ces petits écueils ne viennent pas entamer le plaisir général de lecture, ils destituent néanmoins le roman de son piédestal de « chef-d’œuvre absolu » sur lequel le fanatique du maître auquel j’appartenais l’avait, avant même d’en ouvrir les premières, érigé… La déception est donc bien là…
Vous n’avez plus de crédit
Alors ouais. Lorsqu’on entame Cellulaire, la religieuse retrouvaille s’opère dans des conditions de plaisir inchangées : on sent, dès les premières pages la vieille mécanique, bien rodée, bien huilée, qui se met en branle – ici plutôt rapidement puisque l’horreur vous saute à la gorge dès les premières pages –. Une sorte de rengaine dans laquelle on rentre presque confortablement, comme un bon bain chaud et mousseux ; un truc familier dans lequel on s’installe avec plaisir, qui vous émoustille les sens, et pour lequel la plume de King, son style, n’est évidemment pas innocente.
Alors ouais, l’idée de critiquer la société de consommation en s’attaquant à l’un de ses symboles les plus probant – le téléphone portable, objet fétiche de l’homme moderne, transformé ici en instrument d’Apocalypse, en générateur de Zombies – c’est très fort…
Alors ouais, les personnages sont toujours aussi bien décortiqués. Toujours dépeints avec un réalisme et une justesse et profondeur de caractère qui nous les rend obligatoirement proches et obligatoirement attachants…
Alors ouais, l’action est bien là. Et certaine scène valent quand même le détour…
Mais de l’autre côté de la balance…
…Une intrigue plutôt convenue – voire absente –. Une progression scénaristique d’une horripilante linéarité. Des questions demeurées sans réponses. Du resuçage d’ingrédients pour un magma mi-figues mi-raisins sans réelles innovations…
Finalement, le coup de lifting prend des allures de trépanation. Et le fan de King, au bout de ces cinq cent et quelque pages, referme le bouquin avec un petit pincement qui n’est pas très loin du dangereux signal de frustration. En guise de consolation, il se rabattra illico sur Le Fléau. Ou sur tout autre roman du maître. D’un niveau tout de même supérieur.
Du King qui fait du King et pas autre chose, quoi…
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres